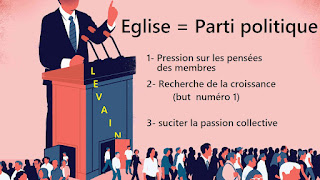403
Par Eric Ruiz
Jésus ne prononçait que très rarement le pronom personnel « je » pour dire je suis comme cela. J’ai envie de cela. Je désir cela.
Il disait plutôt, lorsqu’il parlait d’une mission ou d’un évènement
futur : le « fils de l’homme ».
Comme si cette personne n’était pas lui dans la chair, comme si c’était
quelqu’un d’autre ou bien une particularité générale.
Dans les quatre Évangiles : Jésus d’ailleurs pose la question de son identité à ses
disciples : « Qui dites-vous que je
suis ? »
Et la réponse, n’est pas anodine lorsque Simon Pierre répond : Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant, le oint de Dieu.
Que voulait-il nous montrer par-là, le fils de Dieu ?
D’abord que le « je » n’est pas ce qu’il est lui, puisqu’il
montre la personne, l’égo, son moi, donc soi-même. Et que Jésus ne montrait pas
sa personne, ni sa personnalité propre.
Il s’effaçait au profit d’une autre, puisqu’il ne faisait donc pas sa volonté mais
celle de son Père, (« celui qui m’a vu a
vu le Père » Jean 14 : 9).
Jésus montrait le Dieu invisible qui l’avait envoyé, missionné dans un
corps humain.
-
Donc
le « je, je suis » de Jésus montre sa mission et non sa personne.
La preuve : il disait : « je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs ( la mission auprès de tous les hommes)…je suis le pain de vie (la mission de nourrir l’esprit, l’âme et le corps)…Je ne suis venu non pour abolir, mais pour accomplir (la mission de la grâce) là où deux ou trois sont assemblés je suis au milieu d’eux (la mission de chef de l’Église)…écoutez ce que je dis… pour bâtir sa maison sur le roc (la mission d’enseigner la vérité) … Je suis venu dans ce monde pour un jugement (la mission de juger, discerner où est le mal)…ou encore, « je suis venu jeter un feu sur la terre et qu’ai-je à désirer s’il est déjà allumé ( la mission de révéler le règne du mal qui est déjà là) je suis la résurrection, la vie (la mission de vaincre la mort), je suis la porte, si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé (la mission du salut):
« Je, je suis » : c’est la mission
Lorsque nous renaissons spirituellement ne recevons-nous pas nous aussi une mission, un sacerdoce par l’onction?
Enseignez-leur à observer tous ceux que je vous ai prescrit » Matthieu 28 :20 ; c’est la mission du disciple.
Et cette mission ne nous pousse-t-elle pas à ne plus nous investir en tant
que « je, je suis», en tant que personne, mais en tant que
« nous, nous-sommes» : moi et le Saint-Esprit.
Moi et le Saint-Esprit nous enseignerons à observer tout ce qu’il nous a
prescrit.
Oui, mais il y a une limite cependant… ce « nous, nous sommes » doit disparaître pour ne plus être qu’un, dans un « je, je suis » où l’Esprit ne fait plus qu’un avec le nôtre.
Et à ce moment nous sommes des serviteurs comme notre Père et Jésus le sont
« moi, je
suis au milieu de vous comme celui qui sert » (Luc 22 :27).
Attention à l’erreur commune : cette fonction de serviteur n’est pas
un préambule à celui de maître.
On ne devient pas serviteur puis maître.
Un maître qui cesserait d’être serviteur parce qu’il a acquis un niveau
spirituel supérieur.
-
Mais
le maître, le je suis, se voit dans le service.
Il est passé maître dans son service pour Dieu, dans sa mission.
Sans le Saint-Esprit, je regarde encore à la comparaison et je ne suis
motivé qu’à devenir maître en dépassant celui de serviteur.
Or serviteur est la plus belle fonction de Dieu. En servant les autres je
me sers moi-même. C’est comme cela que Dieu est ; et c’est comme cela
qu’on devient un disciple accompli.
Jésus lavant les pieds de ses disciples, montrait le point d’honneur à son
amour. Sa fonction de serviteur.
Cette fonction, je devrais dire sa pratique est d’autant plus importante qu’elle montre le menteur, le traire, celui qui se refuse à être le serviteur des autres, bien qu’il s’en vante.
C’est ainsi, en servant les autres que nous savons que notre
« je » est pluriel, comme Élohim, un autre nom de Dieu lui aussi
pluriel.
Et même si nous sommes seuls nous savons que nous vivons dans un corps composé d’âmes multiples.
Pourtant chose paradoxale, Dieu se fait appelé « Je suis ».
Alors, est-il finalement centré sur lui-même ? S’aime-t-il lui
seul ?
Exode 3:13-15
"Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui est. Et il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: Celui qui s'appelle "je suis" m'a envoyé vers vous. …Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération."
Donc en apparence « Je suis » semble marquer une réalité divine
permanente et supérieure.
Mais là aussi s’arrêter à la contradiction sans chercher plus loin, c’est
ne pas vouloir mettre la lumière en hauteur pour qu’elle éclaire la pièce
entière.
Le « Je
suis » de Dieu n’est pas un je suis exclusif mais un je suis inclusif.
Dieu inclut sa création en lui.
Dieu a fait placer le tabernacle au milieu des 12 tribus d’Israël. Il ne s’est pas placé à l’extérieure d’elles.
Une des meilleures preuves se trouve aussi dans ce que Jésus
dit : » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père,
et que le Père est en moi? »
(Jean 14 :10).
L’inclusion est totale, fusionnelle même.
C’est-à-dire que le regard divin n’est pas porté directement sur lui-même.
-
Son
regard se porte sur lui quand il se porte sur nous.
Dieu veut se voir en nous, comme
nous-mêmes nous nous voyons dans les autres.
Quand je me regarde, je vois mon corps, ma tête, mes membres, etc.
Quand Dieu se regarde, il voit son corps, ses membres : ceux qui
l’adorent en esprit et en vérité, parce qu’ils font sa volonté.
Et Dieu se voit en bonne santé, avec ceux qui l’adorent en vérité, mais il
se voit aussi malade, accablé, abandonné, méprisé, persécuté, mourant, avec
ceux qui l’adorent qu’en paroles mais dont le cœur s’est éloigné de lui.
Le mal, le mensonge l’accablent, l’idolâtrie le répugne et la tiédeur le
fait vomir.
S’il était toujours en excellente santé, Dieu n’aurait pas besoin d’être
sauveur.
Il se contemplerait et ordonnerait à un peuple d’être entièrement à son service et de l’admirer et de l’ovationner sans cesse.
Mais Dieu « je suis » est tout autre. C’est un Dieu amour ; mais un Dieu qui s’aime à travers les autres. Un Dieu qui évolue par la souffrance (la sienne et celle des autres), par le renoncement, par le sacrifice, par l’abnégation.
Le « Je suis » divin est à l’opposé même de l’égo humain qui ne rêve que de lumière comme Lucifer. Cet être déchu qui rêve de porter sa lumière le plus haut possible.
Je suis celui qui est, ce Dieu c’est : j’existe dans un état d’amour, de souffrance, de renoncement et de sacrifice permanent.
Oui le fardeau est léger pour celui qui fait sa volonté, mais s’il devient lourd ce n’est pas que Dieu a changé d’avis ou qu’il nous a oublié c’est plutôt l’inverse alors. Quand il se regarde, il ne se voit plus ; il ne voit plus le « je suis » qu’il est.
Posons-nous la question que regarde Dieu quand il se regarde, donc quand il nous regarde ?
Exode 25 :8 : « Il me feront un
Sanctuaire et j’habiterai au milieu d’eux ».
Dieu regarde le sanctuaire, celui qui est au
centre de notre être.
Comment est notre Temple ?
Un lieu de piété et d’humilité ou un lieu de marchandage, où l’on pèse ses sacrifices pour en connaître la valeur et après étalage de sa piété, on la vend au plus offrant ? (un peu comme si on se vendait à l’assemblée soi-disant la meilleure)
Bien souvent Dieu n’a pas besoin de rentrer si
profond en nous pour y sonder et y découvrir notre sanctification.
« à l'entrée de
la tente d'assignation, devant l'Éternel: c'est là que je me rencontrerai avec vous, et que
je te parlerai ».
S’il se rencontre avec nous,
c’est bien qu’il se regarde là, à l’entrée de la tente du tabernacle. Il regarde si son « je suis » est le
même que notre « je suis ».
Il voit ce que nous avons mis sur l’autel, ce que nous avons vraiment
sacrifier pour lui.
Il voit si notre offrande est agréé ou mauvaise, de la même manière qu’il a
jugé celle d’Abel et de Caïn.
Il voit si nos actes ont vraiment suivi nos paroles et si notre piété n’est pas un écran de fumé, cachant une bien fausse humilité.
Et là devant l’entrée du tabernacle Dieu regarde son corps et le trouve bien souvent sale, répugnant, dégageant une odeur nauséabonde.
Dieu regarde l’homme aujourd’hui comme il l’a toujours regardé (hier et
éternellement). Toujours devant la porte de son cœur, rien n’a changé.
A Adam Dieu lui demanda pourquoi il se cachait dans le jardin? De quoi avait-il peur? et pourquoi cachait-il son
cœur ?
Aujourd’hui cette question reste la même pour beaucoup de croyants.
Qu’ont-ils à cacher ?
Peut-être : Je suis malhonnête avec mon Dieu, je refuse la vérité en face.
J’en ai déjà parlé : « je suis » c’est le Dieu
invariable ; celui qui place un présent permanent. Tout ce qu’il avait
comme projet, comme tout ce qu’il a prévu est inclus dans le présent.
Il n’a pas changé avec le temps et il ne changera pas. Lui, sa parole, son esprit est oui est amen, c’est un état présent intemporel. Un jour est comme mille ans pour lui. Et il n’est pas enfermé dans un espace où règne le jour et la nuit.
Alors, il a tout prévu pour un corps glorifié, mais aussi, pour un corps maltraité,
humilié, souffrant et pour finir mourant.
Dieu a prévu de sauver son corps par son esprit de consolation, Christ. Il sait que la maltraitance l’amènera à l’humilité, sa nature même. Il sait que la résurrection de son fils sera le remède à la mort et portera beaucoup de fruits. La gloire est à ce prix.
Notre prière se résume donc dans le fait de demander que notre
« je » humain devienne le « je » divin, celui qui nous fait
partagé sa gloire en prenant notre place dans son corps.
La mission de Jésus se voyait clairement, la nôtre doit faire de même.
Sommes-nous capable de dire :
« Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres » ? (Jean 14 :10 )
Car si nous avons le Saint-Esprit, c’est que nous avons obligatoirement aussi le Père.
Cette grâce, Moïse l’avait aussi, Dieu lui avait comme nous aujourd’hui, donné rendez-vous « C'est là que je me rencontrerai avec toi; du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël » (Exode 25 :22).
Alors, soyons attentif à la voix de notre Seigneur qui nous
parle dans notre cœur dans ce lieu très saint, entre ces deux chérubins. C’est
là que notre foi grandie et que notre unité prend forme et que nous pouvons
recevoir ce même nom divin : « Je suis ».
Amen